![]()
FATUM
par Laerte

image issue du site candyworld
Chapitre 4
Lueurs dans la nuit…
L’orage s’était peu à peu apaisé. Le navire militaire tanguait encore dans la brume du crépuscule, mais la menace s’éteignait. Sur les ponts retentissait à nouveau le piaillement de cris échangés parmi les marins, bruits couverts un instant au gré du vent tempétueux embrassant l’océan. Ces hommes de mer retrouvaient la volupté d’une eau calme comme des grenouilles après la pluie. Qui n’aime pas l’air salin de l’océan après une tempête ? La pluie nettoie tout. Elle lave autant les structures que les âmes et quiconque est préoccupé trouve du réconfort dans les chimères de l’humidité. Une renaissance après une mort infligée par la nature. Une meilleure respiration, un regard plus lointain, une sensibilité accrue de l’environnement, bref, une impression que le monde est plus grand qu’il ne l’est déjà.
La jeune femme prit une grande inspiration pour régénérer son sang. Cependant, l’air pénétra si brusquement dans ses poumons qu’elle posa la main sur sa poitrine avec une petite douleur compressive. Elle fut étouffée pendant un instant.
" Mlle Candy ! Vous allez bien ? " - accouru Georges, la voyant se démener.
La jeune fille retrouva son souffle et éclata de rire. La situation était trop ridicule pour qu’elle s’en empêche. Elle referma hermétiquement le hublot avant de se tourner vers le regard inquiet de son compagnon de voyage.
" Oui, oui Georges. Je vais bien.
- Que s’est-il passé, Mlle ?
- J’ai…disons que j’ai voulu redonner un souffle à mes pensées et que le souffle était trop profond… Par chance, je n’avais pas mon corset ! "
En disant ces mots, elle approuva d’un œil rieur sa tenue singulière. Habitué des voyages, Albert leur avait conseillé de porter des tenues modestes de commerçants portuaires pour ainsi se fondre dans la foule une fois à terre. Candy s’était peu formalisée de s’habiller en homme ; au contraire, cela lui rappelait son enfance ponctuée de visites quotidiennes aux cow-boys de l’Indiana, sur le ranch Cartwright.
Voyant que sa protégée se portait bien, Georges esquissa un sourire franc. Elle était charmante dans sa jovialité. Toutefois, comme pour donner raison à son inquiétude, elle retrouva l’air grave qu’elle avait abandonné. D’un main lasse, elle effleura sa tempe droite. Sous sa casquette grise, de vilaines boucles blondes osaient s’échapper.
" Qui a-t-il, Mlle Candy ? Vous ne vous sentez pas bien ?
- Non, je… je pensais, c’est tout.
- Je vois par votre expression que ce sont des pensées amères.
- En effet. "
La jeune femme croisa les bras sur sa poitrine pour calmer le frisson qui la gagnait. Elle s’approcha du hublot à nouveau pour examiner les flots qui frappaient le navire avec voracité, mangeant ainsi la chair d’acier avec avidité. Elle poussa un petit soupir et releva la tête.
" Georges, vous être Français, n’est-ce pas ? lui demanda-t-elle.
- Oui, je le suis. Pourquoi cette question, Mlle ?
- Êtes-vous attaché à votre patrie ?
- Dans les limites du raisonnable.
- Que voulez-vous dire ? – s’enquit la jeune curieuse.
- Que je ne me ferai jamais tuer pour mon pays, quel qu’il soit. "
Candy démontra un nouvel intérêt pour son protecteur. Il ne s’exprimait que rarement et lorsqu’il le faisait, c’était généralement au service du grand oncle William. Les confidences personnelles sortaient au compte-goutte de cette bouche posée. Elle réalisa que, malgré toutes ces années passées dans la famille André, personne ne semblait bien connaître cet homme, qu’il y avait peut-être sous cette carapace à la fois une plus grande distinction et en même temps une vision très précise de l’existence, que celles présentées au reste du monde.
" Vous n’êtes pas du genre patriotique, comme Alistair, n’est-ce pas ?
- Non – avoua-t-il. Je n’ai jamais eu la prétention d’être ce que je ne suis pas.
- Vous voulez dire qu’Alistair prétend au patriotisme ? Que c’est en quelque sorte une excuse ?
- Non, non. Vous m’avez mal compris. Ce que je veux dire, c’est que tous les hommes ne sont pas des héros de nature. J’ignore les véritables motivations de M. Alistair et je ne me permettrai jamais de les questionner.
- Vous ne me dîtes pas toute votre pensée, Georges…
- C’est que toute vérité n’est pas bonne à dire, Mlle…"
Candy sourit. Elle voyait que les paroles de Georges avaient dépassé sa pensée et qu’il faisait un vain effort pour reprendre ce qu’il avait dit. Ce dernier fit un mouvement trahissant son inconfort.
" Comme ce doit être dur de toujours défendre vos maîtres, même si c’est contre vos convictions, n’est-ce pas ? "
- Plus dur que vous le croyez, Mlle " – avoua-t-il en poussant un soupir.
Pour orienter ce sujet pointilleux vers un autre, il proposa à Candy de se reposer un peu mais celle-ci déclina vivement, en rejetant cette proposition d’un signe, préoccupée. Elle avait trop de questions en tête pour songer au repos. Elle parcouru la cabine en long et en large, creusant un sillon imaginaire dans le plancher robuste.
" La raison pour laquelle je vous fais ces questions, Georges, c’est que je m’inquiète.
- De quoi, Mlle ?
- La guerre fait rage là-bas, n’est-ce pas ?
- Dans certaines parties de l’Europe, oui. Depuis la fin de l’année dernière, les soldats français empêchent les soldats allemands d’avancer plus loin en France. Pour éviter de se faire tuer par les tirs ennemis, les deux armées ont creusé des tranchées et s’y s’ont enterrées. Le danger et la mort y rodent… côte à côte.
- Des tranchées ? Qu’est-ce que c’est ?
- Comment dirais-je ? Ce sont des divisions marquées par les deux armées. Chacune de son côté délimite des fossés dont la nature militaire varie jusqu’à l’ennemi. Hum… Il m’est difficile de vous expliquer cela clairement… - sembla s’excuser Georges.
- Ce n’est pas grave ; je le verrai bien moi-même un jour…
- Craignez-vous la guerre, Mlle ? "
Candy se mordit la lèvre, presque instinctivement. Cette question, elle l’avait posée à Alistair quelques mois auparavant, alors qu’il songeait à s’engager. Craignait-il cette guerre ? Non. Il semblait même heureux de partir. Puis, il y eut son renoncement provisoire, pour le moral de Patricia. Toutefois, dès lors, son idée était déjà bien arrêtée. Ses derniers adieux avaient brillés par leur éloquence sur le quai de la gare de Chicago et pourtant, elle n’avait rien vu, n’avait rien su. Et n’avait parlé de cette dernière rencontre à personne.
" Je crains l’horreur de la guerre – répondit-elle. Ce qui me fait peur, c’est de voir une souffrance à laquelle je n’ai jamais été habituée à l’école d’infirmières, de même qu’à l’hôpital. J’ai une image dans la tête d’un tas d’hommes empilés les uns sur les autres, tombés sous les balles ennemies. J’ai peine à m’imaginer la couleur du sang, mais je sais qu’il coule abondamment. Mais ce qui m’inquiète par dessus tout, c’est de voir celui d’Alistair couler à mes pieds.
- Vous ne devez pas penser ainsi, Mlle…
- Je m’efforce de chasser ces images terribles, mais ça m’est impossible. Plus j’approche du but et plus ces images se distinguent. Je me vois, au beau milieu des tirs, tenant un corps mort, encore tout chaud dans mes bras. Je ne peux distinguer son visage dans tout ce sang…"
La jeune femme réprima un frisson violent, alimenté plus encore par l’aspect lugubre de ses pensées que par l’humidité qui perçait la cloison. Par courtoisie, Georges prit son manteau et le déposa sur les épaules tremblantes de Candy, qui le remercia de cette attention par un mince sourire. Dehors, la pluie se remit à tomber en de fines gouttelettes, bariolant la vitre de filets translucides. La jeune femme regarda ce spectacle en silence, se remémorant du même coup les événements des derniers jours.
Albert s’était arrangé avec un de ses amis armateurs pour que Candy et Georges embarquent, moyennant une compensation considérable et la promesse de garder un secret mutuel sur les deux passagers supplémentaires, sur L’Archange, un navire transportant des marchandises militaires depuis Boston au port de la Rochelle, sur les côtes françaises. On surveillait moins les navires de moyen tonnage à cet endroit, le " blocus " des alliés ne s’appliquant pour l’instant qu’au nord du pays. Le sud tentait de survivre de leurs faibles ventes, se concentrant davantage sur l’équipement de guerre et les vivres importés qu’ils envoyaient aux troupes par voie terrestre ou navigable, longeant la côte atlantique.
Candy et Georges devaient, aussitôt en arrivant en sol français, se rendre chez un certain Hugo-Marcel Piron à quelques kilomètres du port, un vieux bourgeois retiré dans ses terres, qui " refusait " la guerre, mais qui n’en était pas moins informé, parce qu’il était Français d’abord et qu’on ne peut être ignorant d’une guerre en son propre pays ; puis parce qu’il échangeait des correspondances avec le Nord. Du moins, c’est ce qui transperçait le plus dans ses lettres à William André. Ce dernier et Georges l’avaient rencontré lors d’un précédent voyage en terre européenne.
Candy et son protecteur resteraient tapis quelques jours chez cet homme, retrouveraient leurs forces et profiteraient de l’occasion pour recueillir des détails sur la situation au nord, avant de poursuivre leurs recherches… la missive envoyée par Alistair n’ayant pas d’adresse de retour.
Candy s’accommodait le mieux du monde de sa petite cabine, partagée avec Georges ainsi que le cuisinier du bateau, un homme grognon mais au cœur plus fort que l’esprit, incapable de dire non aux sourires d’une jeune femme. Il connaissait beaucoup l’Angleterre car il y était né et y avait vécu longtemps avant de s’exiler en Amérique. C’était un ancien forçat dont les méfaits restaient nébuleux mais qui n’hésitait pas à confier, avec une certaine fierté, qu’il avait " fait son temps " dans un pénitencier de la côte est. Ses façons toutes joviales de voir la vie et son évident plaisir d’être libre l’avait racheté aux yeux de l’armateur de L’Archange et de son capitaine. De plus, la nécessité de la guerre ne permet pas d’être difficile pour ce qui est des volontaires prêts à s’engager. Après une brève réticence, Candy en fit son ami ; pendant des heures, ils se remémoraient les paysages et les souvenirs que chacun avaient du Royaume-Uni, sanglotant sur le passé quand la nostalgie les prenait.
À ce moment même, la nuit étant descendue depuis un moment sur les flots, Frank, le cuisinier, ronflait d’une façon gutturale sur sa couche. Candy réprima une envie de rire, tandis que Georges se plaignit en chuchotant qu’ils auraient maintenant bien de la peine à s’endormir. La petite cabine était séparée en deux par un drap épais, seul voile entre la féminité de Candy et la robustesse masculine qui vrombissait de l’autre côté. D’un commun accord traduit par un signe de tête lasse, ils jugèrent qu’il était temps d’imiter leur hôte, la fatigue n’étant pas l’amie du voyageur.
Tandis que la jeune femme se changeait d’un côté, de l’autre Georges en faisait de même. Puis, une fois la permission accordée, Georges passa de l’autre pan de la toile et s’installa sur le lit inférieur, tandis que Candy grimpait dans une échelle étroite pour se coucher sur le lit supérieur. La couche était dure, mais elle en avait vu d’autres. En un éclair, sa mémoire repassa son embarquement clandestin à bord du Seagull quelques années auparavant, la claustrophobie de cette brève expérience partagée avec Cookie dans les cales du navire, la découverte du capitaine, la tempête qui avait compromis une jambe à son ami clandestin et finalement son débarquement en Amérique après tant de péripéties. Cependant, elle avait réussie. De par sa propre volonté, elle avait réussi à rejoindre sa contrée natale. Et voici qu’elle la quittait de nouveau par cette même volonté… une volonté qui faiblissait devant l’inconnu.
Une idée subite lui traversa l’esprit et elle eut un pincement au cœur. Patricia… elle ignorait tout. Elle qui aimait Alistair de tout son être et qui avait peine à retrouver le goût de vivre ne savait pas que son amour était en vie. Mais Candy n’avait pas le droit de lui dire, pour deux raisons ; une promesse subtile que son cousin avait exigé dans cette lettre trop courte et l’incertitude vis-à-vis cette " renaissance " soudaine. Un fol espoir aurait fini par tuer son amie. Mais le secret commençait à peser sur Candy… La jeune femme se demanda tout à coup comment elle aurait réagit si c’était Terry à la place d’Alistair… Puis, elle chassa cette idée, trop brûlante pour son esprit déjà échauffé par les suppositions.
Avant d’éteindre la lampe à l’huile, Georges s’informa si la jeune femme était bien confortable et si elle n’avait besoin de rien. Candy, qui à l’habitude répondait toujours par la négative, hésita.
" Oui, j’ai besoin de quelque chose – affirma-t-elle d’une voix faible.
- Dîtes, Mlle.
- J’ai besoin d’être rassuré, Georges.
- Si c’est sur votre sécurité, soyez sans craintes ; la mer semble s’être calmée et la porte bien fermée. Personne ne nous visitera pendant notre sommeil.
- Non, ce n’est pas cela. Je me demandais si… Georges, dîtes-moi une chose…
- Laquelle ?
- Et si Alistair était mort dans l’intervalle qui sépare sa lettre de notre arrivée en France ?
- Il est malheureusement impossible de le savoir. "
La jeune femme esquissa dans l’obscurité un signe de croix. Elle fit une prière silencieuse où cette fois-ci elle s’adressait non seulement à Dieu, mais également à Alistair ; " S’il te plaît, attends-moi… " - implora-t-elle. Georges lui souhaita une bonne nuit.
" Une bonne nuit… c’est à voir avec un lion rugissant comme voisin ! " - répondit Candy.
Elle rit de bon cœur en voyant Frank faire chorus avec le bruit du tonnerre qui avait reprit, mais qui ne sembla pas déranger le moins du monde le sommeil de ce titan grotesque qui s’époumonait de l’autre côté de la toile, celle-ci vibrant sous l’amplitude du souffle.
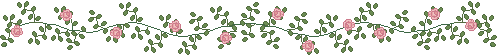
Son impatience et sa révolte s’alimentaient par cette tempête. Il restait debout, prostré à la fenêtre dans une attitude apparemment silencieuse mais qui au fond brûlait comme un feu violent. Il sentait un secret et ça le bouleversait au plus profond de lui-même. L’auréole mystérieuse qui environnait la disparition de Candy le touchait plus qu’il ne voulait l’admettre. Il devait faire montre de dignité et de confiance, mais il criait de tout son être des questions sans réponse. Où était-elle partie ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’Albert savait sur le sujet ? Où était Georges ? L’éloignement du grand oncle et son refus catégorique de répondre aux questions de son entourage les exhortait à l’attente, une attente qui était doublement pénible pour lui-même car le monde sans Candy, ce n’était pas une véritable existence.
Il se retourna et appuya son dos sur la fenêtre, savourant la froideur tant recherchée à travers sa chemise de soie. Les bras croisés, il ne pouvait détacher son regard des lattes du plancher, une fascination qui troublait ses pensées et lui donnait un peu de répit. Mais l’humidité était telle que sa chemise collait à sa peau à certains endroits. Il ouvrit son col pour respirer à son aise, mais c’était inutile. Cette chaleur étouffante lui venait également de l’intérieur. La main sur la poignée dorée de la porte française donnant sur le balcon, il l’ouvrit toute grande et chercha à capter un peu de vent, mais en vain. Cet inconfort et son impuissance vis-à-vis celui-ci le mit en rage. Il émit un grognement de colère, prit le premier objet qui lui tombait sous la main (qui s’avéra être son livre de chevet) et le lança à l’autre bout de la pièce, fracassant du même coup un miroir de table, coquetterie toute féminine, qui tomba sur le tapis bleuté.
Un petit cri de surprise retentit sur le seuil de la chambre, sans pour autant troubler son occupant. Il regarda cette petite silhouette menue, ces cheveux noirs et ce visage angélique, mais son regard ne voyait pas, marqué qu’il était d’un voile imperceptible. Il vit une ombre floue s’avancer vers lui. Ce n’est seulement que lorsqu’il sentit une main délicate se poser sur son bras qu’il reprit conscience de la réalité. Et qu’il s’écarta vivement.
" Ah ! C’est toi, dit-il laconiquement. Je ne t’attendais pas.
- Archibald, qu’est-ce qui se passe ?
- Rien ! "
La brusquerie de cette réponse fit sursauter la jeune femme. Elle le regarda de ses prunelles noires comme de l’encre, essayant de sonder l’esprit de son fiancé, mais celui-ci se déroba vivement à cet examen. Il alla à son secrétaire, fit tinter une cloche. Quelques secondes plus tard, une servante entra. Archibald commanda une liqueur, sans se soucier de ce que pourrait vouloir sa compagne. Celle-ci fit signe qu’elle ne désirait rien et alla fermer elle-même la porte sur les pas de la domestique. Toute cette manœuvre s’était faîte en silence. Lorsque la jeune femme revînt près d’Archibald, celui-ci ne sembla même pas la voir. La tension était palpable entre eux. Elle risqua une question, mais s’aperçu bien vite que ce n’était pas la bonne à poser.
" Est-ce que tu sais ce qu’est devenue Candy ?
- Non, je ne sais pas ! lui cria-t-il à la figure. Je ne sais pas ! Je ne sais jamais rien dans cette maison ! Est-ce que tu sais quelque chose toi ?!
- No…on. Je voulais juste…
- Tu voulais quoi, Annie ? Qu’est-ce que tu voulais de moi, hein ? Que je te dises où elle est ? Je ne sais pas où elle est ! Et ça me rend fou… "
La voix d’Archibald se brisa à ces derniers mots, prenant conscience qu’il ne devait pas trop montrer ses sentiments. Il jeta un regard en coin sur sa fiancée et vit qu’elle avait baissé les yeux pour cacher une larme qui mouillait son œil gauche. Elle se retourna vers la fenêtre, prétextant la grande chaleur pour s’en approcher. Il vit bien dans ses paroles furtives une immense tristesse, mais il ne bougea pas. Il n’y pouvait rien. Ou plutôt, il pouvait tout, mais il n’avait pas envie de la consoler. Il la consolait depuis trop longtemps. Il savait qu’il ne la rendait pas heureuse, mais il n’avait pas le désir d’être joyeux lui-même, encore moins de l’être pour quelqu’un d’autre.
Elle fit volte face et lui adressa un sourire forcé. Elle écarta une mèche noire et rebelle qui lui tombait sur le front. Elle renifla subtilement, leva juste assez les yeux pour le regarder et les abaisser aussitôt, n’osant poursuivre la conversation. Le silence pesant creusait un fossé de plus en plus large entre eux, mais ni l’un ni l’autre ne se risquait ; elle, de peur de déclencher une autre manifestation de colère chez son amoureux ; lui, par crainte de lui faire plus de peine encore. Ce fut la servante qui, revenant avec le breuvage d’Archibald, brisa le silence en pénétrant dans la pièce, après avoir frapper avec hésitation.
" Je vous apporte votre liqueur, M. Archibald.
- Merci, Dorothée. Laisse-nous maintenant. Nous n’aurons plus besoin de tes services pendant un moment.
- Bien, monsieur. "
Dorothée se retira rapidement après une révérence, refermant les portes. Archibald prit sa liqueur sur le plateau, la but en deux gorgées et reposa le verre en un mouvement lent, comme s’il pensait à autre chose. Puis, mû par cette préoccupation intérieure, il leva son regard inquiet sur Annie.
" Comment va Patricia ? Elle s’accommode bien dans ses appartements ?
- Oui, je crois. Elle se sent un peu seule, mais elle semble contente de pouvoir dormir dans l’ancienne chambre de Candy. Et elle…
- C’est toujours sa chambre, même si elle n’y vit plus ! ", l’interrompit-il.
Annie darda son regard sur lui, renonçant à cacher ce qui la tracassait. Calmement, elle se rapprocha de lui et lui toucha la joue. Il ne se déroba pas, mais ne sembla pas touché pour autant. Cette caresse n’effleura son cœur que légèrement. Il ferma les yeux et se souvint du merveilleux jour où Candy l’avait touché ainsi, sa paume chaude et réconfortante glissant en un geste affectueux sur sa joue marbrée de larmes. C’était aux funérailles d’Alistair. Malgré sa peine, il s’était senti revivre à ce moment-là. Puis, elle avait fait de même pour Patricia et Annie, ce qui avait détruit un peu l’exclusivité de cet instant magique. Mais il s’en souvenait encore, gardant précieusement ce souvenir comme un trésor, comme un espoir fou… un espoir qui ne servait à rien. À cette pensée, il soupira douloureusement et rouvrit les yeux. Ce qu’il vit dans ceux d’Annie l’ébranla soudain..
Ce n’était ni de la haine, ni du désespoir, ni une grande tristesse, mais plutôt une résignation qui le surprit. Elle se résignait. Elle savait. Elle devait savoir, elle, femme sensible, les sentiments qu’il éprouverait toujours pour Candy. Ne l’avait-elle pas deviné au collège, avant que Candy s’en doute elle-même ? Et elle acceptait, elle acceptait de passer au second rang. Pour le moment. Mais qu’en serait-il de l’avenir ? Elle était, au premier abord, une jeune femme dans toute sa fragilité, touchée plus que les autres par les turpitudes de la vie, malgré l’éducation stricte et sophistiquée reçu chez les Brighton. Cependant, il sentait chez elle une face cachée, une révolte qu’elle gardait précieusement mais qui sortirait un jour, sans crier gare. Après tout, elle avait vécu près de dix ans dans un orphelinat, abandonnée, ayant pour principal modèle une intrépide et trépidante jeune fille aux boucles blondes qui ravageait tout sur son passage. Tout, même son cœur à lui.
Candy… Combien de fois l’avait-il espéré parmi toutes les jeunes filles rencontrées dans des soirées mondaines. Aucune n’avait répondu à ses attentes. Il s’amusait à les charmer, les envoûter, puis les laisser dans l’incertitude d’un amour qui se révélait toujours impossible en raison de son idéal. Mais elle… Comment pouvait-il savoir que cette jeune fille, qui savait si bien mener le lasso, en le sauvant, allait entrer dans sa vie et tout bouleverser par son sourire et son impétuosité. Il avait perçue chez elle une grâce naturelle, un instinct qu’elle n’avait pas à forcer pour être admirée.
Admirée, elle l’avait toujours été. Par lui-même, d’abord. Puis, par son frère qui avait toujours tut son amour par respect pour elle, chose que lui, Archibald, n’avait jamais pu ; puis, par Anthony, qu’il avait secrètement envié de lui avoir pris le cœur… Et Terry… Il fronça les sourcils en prononçant ce nom. Jamais il ne lui pardonnerait ! Jamais il n’accepterait ! Quant à Albert, une certaine pudeur lui refusait de penser du mal de lui, car il était son grand oncle, d’abord, puis parce qu’il n’était pas sûr de ses sentiments. Personne ne possédait la clé de ses pensées, ni de son cœur. Malgré son retour dans la famille, il restait aussi énigmatique que lorsqu’il parcourait le monde à la recherche d’un sens à son existence. Elle était admirée également par Daniel, chose qu’il exécrait, d’abord parce que celui-ci ne serait jamais digne d’elle, puis également en raison de tout le mal que lui et sa sœur avaient causé.
Il savait également qu’Annie souffrait beaucoup, car elle aussi se tournait vers sa compagne de toujours et la prenait pour un pilier, cherchant constamment son approbation pour chaque décision majeure de sa vie, comme si elle essayait de racheter par ces gestes une erreur passé… Laquelle ? Il n’avait jamais cherché à le savoir jusqu’à maintenant, mais il était sûr qu’Annie se sentait coupable de quelque chose envers Candy et qu’elle cherchait un moyen de se racheter.
À cette étape de ses réflexions, il reposa son regard sur sa fiancée et un sentiment plus humain lui vint. Il entoura ses épaules dans un geste affectif et posa ses lèvres sur son front, sans toutefois changer de physionomie. Inspirée par cette étreinte distante, Annie resserra l’étau de ses bras autours de la taille mince d’Archibald, appréciant le doux tissu de la chemise et le parfum envoûtant qui l’embaumait. Lui, fixait la roseraie au travers de la fenêtre. Cette étreinte le mortifiait autant qu’elle lui donnait une force qu’il ne pouvait s’expliquer. Il aimait bien Annie, après tout. Elle était charmante, faisait tout avec grâce et simplicité. Puis, elle l’aimait, ce qui l’aidait à redescendre sur terre, à se rappeler que Candy ne l’aimerait jamais, lui. Il s’était souvent posé cette question ; pourquoi ne l’aimerait-t-elle pas ?
La réponse, c’est Alistair qui l’avait donné ; " parce que sa passion est trop forte, mon frère, et qu’elle nous perdrait… si ce n’est pas déjà fait… ".
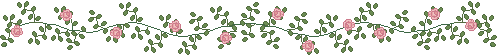
La nuit vaporeuse descendit lentement sur le crépuscule rosé, ses étoiles scintillantes redorant de leur éclat l’obscurité maladive qui régnait dans l’hôpital improvisé. Les corps jonchaient le " plancher ", s’éparpillant sur le bois moisi par le sang, les pleurs et les médicaments renversés. À droite, des militaires abattus, au seuil de la mort, n’ayant que pour seul réconfort la main douce d’une infirmière zélée, pour qui le devoir ne s’arrête jamais au sommeil de ses patients. À gauche, les zestes de familles recherchant secours, réconfort mais surtout nouvelles ; non celles d’une guerre sanglante pour qui la vie n’était que statistique mais celles d’un ami, d’un père, d’un mari, d’un frère qui sévissaient sous le joug du patriotisme pour certains, de la conscription pour d’autres, perdus dans le tourbillon d’un idéal que les hommes définissent facilement comme le devoir de la nation mais que les cœurs tristes appellent vains sacrifices.
Au fond de la lugubre salle se profilait une ombre masculine. Debout, appuyé à un bureau, la tête en prière, cette silhouette semblait plier sous le poids du désespoir. Tapis dans cette obscurité protectrice, il pouvait laisser libre cours à ses pensées, certain qu’aucune oreille ne pourrait lire dans son âme. Car c’était un livre que cette âme ; un récit qui aurait pu être héroïque mais qui n’était devenu qu’un manuscrit parmi tant d’autre, refoulé sous une épaisse couche de remords poussiéreux et encombrants.
" Qu’est-ce qui m’a pris de venir ici ? - se disait cette ombre. J’aurais du rester où j’étais. J’étais bien là-bas. Pourquoi moi ? Pourquoi faut-il que le sort s’acharne sur moi ? Qu’ais-je donc fait au monde pour être si malheureux ? "
Sans s’en rendre compte, il avait exprimé cette pensée à voix haute. Le médecin-chef, qui passait tout prêt, s’arrêta subitement et toisa ce militaire avec un mélange de sarcasme et de curiosité.
" Comptez-vous chanceux, plutôt, d’être encore de ce monde ! – s’écria le docteur. A-t-on jamais vu pareil ingrat !
- Je vous demande pardon ? - s’étonna l’interpellé en levant la tête.
- J’ai dit que vous étiez ingrat, mon ami ! J’aurais jamais cru qu’on pouvait regretter d’être en vie ! Vous n’étiez pas si fier quand on vous a amené ici…"
Sans dire un mot de plus, l’homme gringalet se détourna. Il alla ausculter le cœur d’un corps inerte sur la table d’examen, rare lit potable restant dans le confinement suintant de ce chapiteau. Constatant la mort, il ordonna à ses aides de couvrir le corps d’un drap et de réserver cette place nouvellement vide aux prochaines chirurgies.
À travers la cloison mince de la toile de lin, à la lueur d’une lampe à l’huile, se dessinait la fameuse croix rouge, fresque fantomatique de ces sauveteurs bénévoles, quasi-étrangers à la cause du conflit. La blancheur des uniformes se mêlaient au sang vif des patients et la crasse terreuse qui s’incrustait par les joints du sol, et ce malgré les efforts démesurés du personnel médical pour garder l’endroit salubre.
" Ne t’en fait pas, monsieur – lança une voix douce. Moi, je te crois. "
Le militaire tourna la tête à droite et fut surpris de n’y voir personne. Il crut être victime d’une hallucination lorsqu’une main toute chétive se posa sur son uniforme et qu’au bout de ce petit bras se dessinait, dans la faible lumière, la forme d’un nain. Cependant, la répétition de ce " moi, je te crois " confirma plutôt au soldat que ce membre gracile appartenait à une petite fille. Une petite fille ?! Ici, dans toute cette tragédie ? Son étonnement fut si grand que sa bouche s’ouvrit béatement et que ses yeux s’agrandirent d’incompréhension. La petite fille éclata alors d’un rire de cristal, en plissant ses petits yeux noirs.
" T’es drôle, monsieur – lui lança-t-elle, lorsqu’elle eut repris son souffle. Tu le fais encore ? "
Le soldat eut quelque peine à comprendre. Puis, il rit avant d’exécuter la même grimace d’étonnement, en exagérant maintenant ses traits. La petite fille éclata de plus bel, ce qui fit se retourner quelques têtes curieuses de cette gaieté. Personne s’en offusqua cependant. Il y a un certain interdit à retenir les rires d’un enfant lorsque celui-ci semble éloigner les noirceurs de la vie, ne serais-ce que pour une minute ou deux.
Au grand étonnement du militaire, la petite leva les bras, lui signifiant son désir d’être portée. Il hésita un peu avant de la prendre, mais devant sa joie si spontanée, il ne pu refuser et passa ses mains sous ses aisselles. En la blottissant sur son cœur, il sentit la fraîcheur de l’enfance et ferma les yeux. Tous ces mois de destruction, de perte, d’assimilation, de batailles incessantes lui avaient embrumés les sens. Pour une cause qui lui semblait nébuleuse aujourd’hui, il avait combattu avec témérité, alors qu’il avait promis de le faire seulement avec courage. Il en avait payé le prix ; la souffrance humaine. La souffrance physique de son propre corps. La douleur dans chaque muscle, le sang dans la bouche, la brume dans les yeux, les élancements dans la tête, la peur dans l’esprit, la compression dans le cœur. Tout en lui avait souffert. Tout en lui s’était brisé.
Du moins le croyait-il. Maintenant, avec cette odeur particulière aux enfants, cette tignasse presque rouge, ce sourire à fendre l’âme, il sentait quelque chose renaître en lui… Un sentiment encore flou, flottant entre deux mondes parallèles qu’il regardait en spectateur. L’anéantissement d’un côté, la résurrection de l’autre. Cette petite, qui semblait le " croire " avec tant de fermeté lui redorait l’échine. Il en oublia presque qui il était et où il se trouvait.
" Quel est ton nom, petit démon ?
- Luciole – prononça-t-elle faiblement, comme pour n’être entendu que de lui.
- C’est ton vrai nom ?
- Oui, monsieur.
- Alors, toi, tu me crois quand je dis que je suis malheureux ?
- Oui.
- Et pourquoi tu me crois ? Parce que j’ai l’air triste ?
- Non. Parce que tu as prononcé un nom. "
Le soldat s’étonna devant une telle explication. Il ne se souvenait pas d’avoir prononcé un seul nom durant ses réflexions précédentes. Mais devant l’air convaincu de la petite, il se questionna lui-même.
" Quand m’as-tu entendu prononcer un nom ?
- Quand tu étais parti dans l’autre monde, monsieur.
- Dans l’autre monde ? Qu’est-ce que tu veux dire ?
- Ils ont tous cru que t’était mort. Moi j’ai dit non, que tu l’étais pas. J’ai crié au grand monsieur avec le serpent à deux têtes que t’étais toujours vivant. "
L’incompréhension se lisant sur le visage de son nouvel ami, la petite fille tourna lentement la tête, sembla chercher quelqu’un dans la pièce et pointa en direction d’un autre homme, penché sur les blessures d’un inconscient. Le " grand monsieur " prit son " serpent noir à deux têtes " et ausculta le patient. Le soldat rit alors de la comparaison.
" Et le grand monsieur a fait que t’étais plus mort.
- Alors, je te dois la vie, petite lumière – constata le soldat.
- Mon nom, c’est Luciole, pas lumière – fit-elle avec une moue déçue. Dis, est-ce que t’es triste parce que tu as perdu ta mère ? "
Le militaire, surprit de cette question, plongea malgré lui des années en arrière. Il y a bien longtemps qu’il n’avait pas songé à sa mère, encore moins à son père. Ils étaient probablement morts, ou à tout le moins tentaient de survivre à la guerre, quelque part. Probable qu’ils aient été en terrain ennemi lorsque la guerre s’était déclarée. Son père avait toujours flirté avec le risque. Sa mère l’avait toujours suivi, avide secrètement de ce genre de vie. Peut-être leur ressemblait-il… Pleurerait-il la mort de ses parents si ils venaient à mourir ? Il en doutait.
" Pourquoi me demandes-tu ça, Luciole ?
- Parce que moi j’ai perdu la mienne, hier. Et mon papa aujourd’hui… "
Elle désigna presque machinalement le corps recouvert d’un drap, ce même corps qu’on venait d’enlever de la table d’opération quelques instants plus tôt et qui reposait maintenant dans un coin, en attendant qu’un volontaire veuille bien lui creuser une sépulture décente. Le soldat eut un pincement au cœur et sa gorge se noua.
Puis, son attention passa du corps sans vie au regard pétillant de la petite. Son joli minois frémissait, ses yeux s’embuaient, mais elle refoula ses larmes avec toute la ténacité qu’elle pouvait y mettre. Elle plongea son regard noir dans celui de son ami. Son front plissé, les sourcils froncés, elle prit la mâchoire de l’homme dans ses mains, étudiant avec précision chaque détail de ce visage adulte marqué par la souffrance. Elle sembla y trouver ce qu’elle cherchait, puisqu’au bout d’un moment, elle sourit.
" Alors, toi tu me comprends…
- Pourquoi dis-tu que je te comprends ?
- Parce que toi aussi tu as perdu quelqu’un, monsieur. "
- C’est vrai – avoua-t-il, envoûté par ce regard pénétrant.
- Elle s’appelait Candy."
Ce nom lui glaça les veines. La petite démone était-elle progéniture de sorcière ? Il comprit toutefois, après quelques instants de stupéfaction, que ce nom était celui qu’il avait prononcé dans son délire. La petite en avait été témoin et savait maintenant qu’il souffrait comme elle de la perte d’un être cher. Le ton de sa voix, la fréquence de ce nom prononcé, la crispation de son corps… Lequel de ces éléments l’avaient trahi ?
" Elle est morte, elle aussi ? – questionna Luciole.
- No…non, je ne crois pas – réussit-il à articuler.
- Alors, pourquoi es-tu triste ?
- Parce que… parce que…
- Parce qu’elle t’a fait du mal ? "
Le soldat ne répondit pas. Il ferma les yeux une seconde et tenta de mettre ses idées en ordre. Ce soudain partage avec un être aussi innocent que cette petite le brûlait plus qu’il ne voulait se l’admettre. Une par une, cette magicienne ouvrait toutes les portes closes de son cœur et y trouvait tous les secrets qu’il voulait garder enfouis. Il avait toujours trouvé les confessions inutiles puisqu’elles ne changeaient en rien ce qui se passait à l’intérieur de soi, sauf peut-être un soulagement passager. Mais s’ouvrir ainsi, sans retenue, prouvait qu’il s’était trompé et qu’il avait besoin d’extirper ce qu’il confinait en lui, comme s’il voulait débarrasser son corps d’une fièvre mortelle.
" Oui, petite. Elle m’a fait du mal… "
La petite pencha la tête philosophiquement, comme si elle comprenait toute l’étendue psychologique de cette révélation. Elle lui signifia qu’elle voulait regagner le sol. Il la déposa presque avec regret, ayant pris goût à la tenir dans ses bras. Son flanc et son épaule gauche étaient encore tout chaud de sa présence. Il sentit l’air taquin du soir mordre sa chair à cet emplacement et un frisson le parcouru en entier. Cette petite brûlante l’avait laissé dans le froid de son âme. Elle lui prit la main et le força à la suivre. Il s’exécuta, non sans sentir la faiblesse de ses jambes.
La petite Luciole s’arrêta devant le corps de son père. Elle pencha à nouveau la tête de côté, scrutant d’un air suspect le morceau de chair enveloppé. Voilà tout ce qui restait de sa famille. Sa mère avait été enterrée la veille et maintenant, c’était le tour de son père. Elle n’avait pas d’autre famille. La guerre en avait fait une orpheline.
" Tu vas m’aider à enterrer mon père, dis ?
- Bien sûr.
- Et je vais pouvoir rester avec toi après, monsieur ?
- Oui.
- C’est quoi ton nom, monsieur ?
- Alistair. "
Quelques temps plus tard, en Amérique, Candy recevait la lettre de son cousin lui disant qu’avant de revenir, il avait quelque chose à faire… Candy ignorait encore qu’il s’agissait de s’occuper d’une petite fée rouquine qui savait aussi bien lire dans les âmes qu’un astrologue dans les étoiles…
© Laerte août 2001
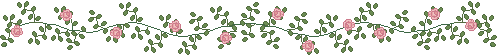
Merci à Magnus Nono pour cette superbe image de Candy. ^_^